« La route est réparée | Page d'accueil | Première sortie de l'anonymat ? »
samedi, 16 avril 2005
A nos chers disparus
Plus les années passent, plus probablement l’échéance approche (déchéance ?) pour moi-même, et plus je trouve étrange cette façon intimiste avec laquelle on s’adresse aux morts, en les tutoyant toujours, en les appelant par leur nom le plus personnel, leur petit nom le plus familier, voire parfois le pseudonyme le plus clandestin… Il est toujours tant de faire des révélations la mort advenue quand elles valorisent (ou dévalorisent selon le sens ou le degré d’implication de l’auditeur de ces révélations) potentiellement celui qui les fait au moins tout autant que celui qui en est le sujet. Enfin, faut quand même pas s’emballer tout de suite là, je n’ai aucunement l’intention de faire des révélations sur quiconque, ni sur moi-même, ni ici ni ailleurs. D’ailleurs. Très franchement, n’ayant moi-même jamais réellement été intéressé plus sérieusement qu’au niveau de la curiosité vénielle par les aveux, les confessions ou les secrets… je n’aurais donc rien à déclarer sur la question. Mais, bon, hum, tout le monde sait ce que cela signifie quand on se croit obligé de mettre en avant des formulations rhétoriques du genre « très franchement », ou « sincèrement »… Bref, je voulais juste dire que, dans le temps, avant les quelques dernières guerres qui ont ensanglanté cette planète bleue, pour exprimer publiquement mon deuil, il m’arrivait de vouloir rendre un hommage… euh, disons symboliste aux chers défunts. Et de le faire publiquement, par écrit, dans un journal ou une revue militante par exemple, ça donnait tout de suite une résonance émotionnelle maximum à l’hommage. Et si en plus, par goût des mots, je tentais un style poétique (en poésie, on est toujours ringard pour quelqu’un, alors, hein, même pas honte !), je réussissais à tous les coups à tremper mon papier de mes humeurs les plus impudiques. Des larmes d’encre à sérigraphier, quoi, je vous en expurgeais en veux-tu en voilà, à tel point que j’étais en quelque sorte devenu un spécialiste de l’hommage touchant à la Une. Pour devenir expert il m’aurait tout de même manqué le professionnalisme qui garantit contre les souffrances authentiques car, et je ne me la joue pas, à chaque fois que j’écrivais ces trucs à fondre, eh bien je fondais, lentement, très lentement, très très douloureusement, mot après mot, virgule après virgule, « tu » après « tu » je faisais revivre le cher disparu dans ma chair… et je disparaissais de honte. Oui c’est exactement ça, je me souviens très très bien que, chaque fois, j’aurais voulu disparaître plutôt que de revendiquer une telle impudeur exhibitionniste des sentiments. Et pourtant, cette impudeur, maintenant je le sais, eh bien elle était le flux essentiel de mon écriture. Même si, le plus souvent, écrire est une thérapie, c’est avant tout pour être lus (et pour être aimés) que la plupart des gens enfilent les mots comme on aligne des piquets pour se démarquer de l’anonymat. Donc, à cette époque-là, je trouvais ça tout à fait naturel, digne, émouvant et nécessaire ces hommages rendus à nos chers disparus. Maintenant, plus. Oui encore assez émouvant, plutôt digne aussi il se peut, mais plus du tout nécessaire. Et, j’ai beau me tordre la cervelle trois fois dans le crâne avant d’avouer mon incompréhension, je ne saurais donner aucun début de commencement d’explication à cette perception de l’étrange qui me fait ainsi qualifier, désormais, la façon que l’on a de parler aux morts. Bon, je suis cru, là, ce soir, sans plus de souci de fioritures, mais un mort c’est sourd, c’est aveugle, ça ne sent rien, ça pourrit tout doucement ou ça brûle pour se transformer en cendres que l’on dissout symboliquement dans le Grand Tout. Symboliquement. Symbolique. Ment. Merde, le deuil, c’est le regard des autres sur votre douleur, le jugement des vivants sur votre appréhension de l’absence, pas le regard du mort. Le mort il est mort et rien d’autre. Pas juge, même pas un tout petit peu rancunier. Plus fier pour deux sous. Humble comme peut l’être, « très franchement » et « très sincèrement » l’inexistant, tout simplement. Le deuil ce n’est que le rapport de la société avec la mort, et non pas le contraire. La mort elle se fout de la société comme de sa première faucille !
Alors moi, là, aujourd’hui 16 avril 2005, près d’un mois après la disparition d’un énième cher défunt, j’aurais envie de tout sauf de tutoyer le mort pour lui rendre hommage. Tiens, là, pareil que j’aurais envie de faire la bringue comme je la faisais avec ce cher disparu-là, il y a des lustres et des lustres qui éclairent ma nostalgie. Une putain de super-bringue à chanter très fort à trois voix, moi plutôt criant pour barytonner les moustaches mousseuses et la gorge éraillée par la tabagie à trois paquets la soirée. J’ai toujours bien aimé que ça marche par trois. Je me suis toujours dit que sur trois pieds on ne pouvait pas boiter. Oui une super-fiesta, siempre, tant qu’il y a de la vie y’a d’l’espoir… Mais la fête, aujourd’hui, je n’ai pas osé la faire avec des gens qui, eux, ne voient pas l’étrange où il y a du bizarre. Oui ce putain de deuil à la con, faut être sur la même longueur d’ondes pour se le jouer façon concert public. Et moi je me sens sur des ondes ultra-courtes. Là. Je me dis qu’il y aura forcément un empaffé pour me reprocher ceci ou cela, pour prétendre que le cher disparu n’aurait pas accepté ceci ou cela, que donc ceci ou cela. Et que le ceci ou cela indésirable ce pourrait être mézigue, ma pomme, moi la paille et la poutre dans l’œil du voisin. Moi qui me refuse désormais à tutoyer la mort car il faut toujours être très poli avec les gens mieux armés que vous, voire obséquieux si nécessaire. Ça c’est nécessaire oui, pour survivre encore un peu. On ne sait jamais, ça pourrait porter malheur que de dire « tu » à une ombre qui sait vous tuer à coups de crabe et de métastases. Hum, là je rigole. Gogole. Oui. Enfin, je ne sais plus. Disons que je me réfugie dans une autodérision de pudeur… Pour n’avoir rien à regretter. Rien que du disparu, du vide, du pourri, des cendres.
Le souvenir, par contre, je le conserve, bien au chaud dans mon intimité. Il m’est tout à fait personnel, unique, impartageable. Très cher.
Le plébéien bleu
23:50 Publié dans digression | Lien permanent | Commentaires (0)




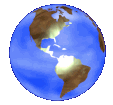

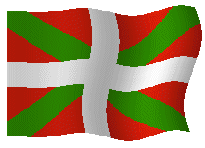
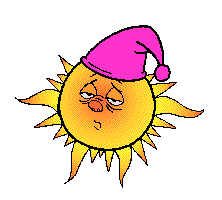








Les commentaires sont fermés.