« Dopo Mezzanotte : | Page d'accueil | Misère et malheur préfèrent le noir »
vendredi, 26 août 2005
Ils ont incendié l’astre des poètes
Et Armstrong n’aurait pas
marché sur la Lune
Voilà cinq mois que j’écris plus ou moins irrégulièrement sur ce si joli blog tout bleu, bleu comme la planète bleue, cette glèbe bleue commune à toutes les plèbes, y compris la plèbe basque ou bayonnaise, bien évidemment… Cinq mois de coups de gueule et de coups de cœur, cinq mois de digressions, d’essais sur la diversité de l’art ou du vulgaire, de petits délires person- nels parfois, cinq mois pendant lesquels j’ai osé une toujours incertaine exhibition des mots et des sentiments au travers de plusieurs tentatives littéraires ou poétiques, cinq mois et un jour exactement. Aujourd’hui, vendredi 26 août 2005, j’ose avouer, exhiber un gros coup de blues –passager, il faut l’espérer--, un gros bleu à l’âme, une sorte d’ecchymose cervicale, une es- pèce de tristesse majeure, un dégoût. Aujourd’hui, je cache ma langue toute bleue dans ma bouche, derrière mes dents qui sont tellement frustrées de ne pouvoir mordre, derrière mes lèvres en manque, en manque des lèvres de Mamour qui rentrera sûrement bien tard ce soir. Olivier Baratchart l’a affirmé, les taureaux qu’il vient d’aller chercher à Salamanque ne sont pas atteints par l’épidémie de la langue bleue, non transmissible à l’homme. Je n’irai jamais voir une de ses foutues corridas criminelles et sadiques, bien évidemment… mais j’ai quand même la langue toute bleue. La langue et les doigts. Mes doigts tout bleus sur le clavier tout noir, mes doigts révoltés qui se refusent à pianoter une musique d’ambiance, un refrain d’actualité plus que jamais catastrophique sur toutes les chaînes de radio, de télé, sur toutes les chaînes qui me paralysent. Des morts partout, des morts violentes, bien évi- demment, à tous les étages, jusqu’au dernier où l’on ne pourra pas identifier les cadavres carbonisés. Noirs sous le noir, Afrique sans le frique, en plein Paris. Au cœur de mon dégoût, le cœur au bord des lèvres, la tête à la fenêtre pour reprendre mon souffle, à Bayonne, depuis ma planète bleue à moi, je la vois tout de même encore cette Lune qui inspira, sous mon regard stupéfait d’enfant, un si grand pas pour l’humanité. Et je décide de penser à autre chose. De digresser pour oublier cet immeuble en flammes dans la nuit. Tous ces incendies, ces bombes de chair et d’os, tous ces barreaux n’existent pas, n’existent plus si on décide de ne pas en parler, si on choisit de parler d’autres choses, de tout autre chose, de «sport» par exemple…
Il y a quatre cent trente trois mois et six jours exactement, le 20 juillet 1969, Lance Armstrong n’était même pas encore né, mais peut-être y avait-il déjà des traces d’EPO dans les tes- ticules de son père. Peut-être pas. Tout le monde s’en fout. Mon père à moi ne se dopait pas pour aller monter ses murs à mains nues, des murs comme des murailles jusqu’au ciel à mes yeux de fils admiratif. Je n’en suis pas certain mais il me semble bien qu’il a participé à la construction de cette muraille sociale de la ZUP, à Bayonne. Cette muraille que l’on n’aperçoit tout de même pas depuis la Lune. Chaque fois que je passe devant elle, les souvenirs affluent, rien que les meilleurs, bien évidemment… C’était une nuit, une nuit d’été, nous venions de faire l’acquisition de notre premier poste de télévision, et j’étais fasciné, seul sur le canapé de la salle à manger, hypnotisé par la pâleur bleutée des images de cette retransmission en directe. En Pays basque c’était la nuit, alors que de l’autre côté de l’Atlantique il devait faire grand jour, grand jour pour la fierté impérialiste des «maîtres» du Monde, jour J de la conquête de l’espace par les Américains. Les Américains avaient eu la chance de voir ces images inoubliables commentées en direct par Robert Anson Heinlein et Arthur C. Clarke. Ce devait être encore plus génial. Ça, je l’ai appris bien plus tard, évidem- ment… L’ORTF avait dû faire appel à Pierre Dumayet ou Pierre Sabagh, ou à Léon Zitrone, je n’en sais foutre rien. Mon cerveau juvénile n’a conservé aucun souvenir de ce genre, l’émotion était sûrement beaucoup trop forte pour que je puisse me concentrer ne serait-ce qu’un instant sur un aspect tout à fait périphérique de l’événement. D’ailleurs, il y a peu, j’en ai parlé avec une amie. C’est elle qui m’a suggéré les noms des animateurs de Cinq colonnes à la Une.

Maintenant, avec le recul et l’érosion des années, je crois que j’aimerais pouvoir m’en souvenir, pouvoir mettre d’autres noms sur cet événement fondateur de ma différence. Identifier les témoins en quelque sorte, des témoins vivants, ça serait mieux. En fait, si j’écris cette étrange note, ce soir, c’est probablement dans l’espoir que quelqu’un, quelque part, sur la Lune peut-être si internet va jusque là, qu’un témoin de ce 20 juillet 1969 devant l’écran unique de la télévision française lira ces lignes et saura me répondre. Léon Zitrone ou ses collègues ont-ils menti ? Les hommes ont-ils réellement un jour, celui-ci ou un autre, posé le pied sur l’astre blême de tous les poèmes ? Neil Armstrong serait-il un imposteur, un affabulateur, ou carrément un mythe ? Une des constantes paternalistes de mon géniteur aura été de nier l’authenticité des images que nous donnait à croire la télévision (que penserait-il d’internet aujourd’hui, je doute fort que cette «modernité» lui apparaîtrait plus crédible), et des exemples pour fonder son incrédulité, il pouvait en citer à la pelle, mais il se contentait toujours du même. Comment pouvait-on croire des images qui nous montraient Fernandel bien vivant dans «La vache et le prisonnier» ou dans un autre film --peu importe, c’était toujours Fernandel qui nous servait de démonstration-- alors que mon père savait bien qu’il était mort ? Il ne fallait pas lui la faire ! Je me suis toujours demandé comment papa pouvait être aussi certain du décès de Fer- nandel… mais, bien évidemment, je n’ai jamais osé l’interroger à ce propos.
Cela fait cent cinquante cinq mois et vingt deux jours qu’il est mort. Non pas Fernandel mais mon père, ça j’en ai la preuve. Je l’ai vu de mes yeux, j’ai baisé de mes lèvres sa froideur ca- davérique. Maintenant il est retourné à la glèbe, la glèbe d’un cimetière avec vue sur l’océan, tout de même. Un jour, des maçons construiront de belles maisons sur cette colline. Un de ces maçons aura peut-être un fils déçu que son père ne veuille pas partager son rêve cosmique. Un jour où il ne sera plus du tout important pour moi de savoir si les hommes ont marché sur la Lune ou non. Ce jour-là le rêve ira bien plus loin encore j’espère… Mais, ce soir, cette triste soirée du vendredi 26 août 2005, dans les décombres fumants d’un immeuble de misère, des larmes transparentes effacent mes futiles digressions. Il doit hurler son incrédulité, ce petit garçon qui a perdu ses parents la nuit dernière. À quoi bon s’en aller frimer dans le ciel alors qu’on n’a plus de toit sur la tête ! Lance Armstrong, quant à lui, il peut bien s’en aller gagner le Tour de la Lune, avec ou sans EPO, à l'angle du boulevard Vincent-Auriol et de la rue Edmond-Flamand tout le monde s’en fout !
Le plébéien bleu
22:20 Publié dans digression, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)




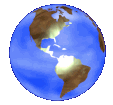

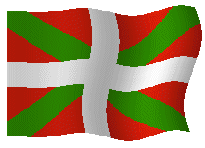
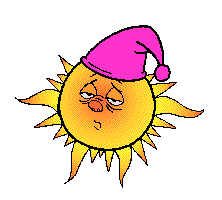








Les commentaires sont fermés.