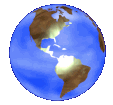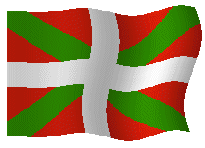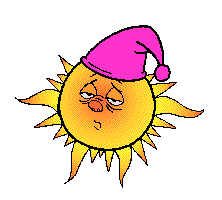vendredi, 26 août 2005
Ils ont incendié l’astre des poètes
Et Armstrong n’aurait pas
marché sur la Lune
Voilà cinq mois que j’écris plus ou moins irrégulièrement sur ce si joli blog tout bleu, bleu comme la planète bleue, cette glèbe bleue commune à toutes les plèbes, y compris la plèbe basque ou bayonnaise, bien évidemment… Cinq mois de coups de gueule et de coups de cœur, cinq mois de digressions, d’essais sur la diversité de l’art ou du vulgaire, de petits délires person- nels parfois, cinq mois pendant lesquels j’ai osé une toujours incertaine exhibition des mots et des sentiments au travers de plusieurs tentatives littéraires ou poétiques, cinq mois et un jour exactement. Aujourd’hui, vendredi 26 août 2005, j’ose avouer, exhiber un gros coup de blues –passager, il faut l’espérer--, un gros bleu à l’âme, une sorte d’ecchymose cervicale, une es- pèce de tristesse majeure, un dégoût. Aujourd’hui, je cache ma langue toute bleue dans ma bouche, derrière mes dents qui sont tellement frustrées de ne pouvoir mordre, derrière mes lèvres en manque, en manque des lèvres de Mamour qui rentrera sûrement bien tard ce soir. Olivier Baratchart l’a affirmé, les taureaux qu’il vient d’aller chercher à Salamanque ne sont pas atteints par l’épidémie de la langue bleue, non transmissible à l’homme. Je n’irai jamais voir une de ses foutues corridas criminelles et sadiques, bien évidemment… mais j’ai quand même la langue toute bleue. La langue et les doigts. Mes doigts tout bleus sur le clavier tout noir, mes doigts révoltés qui se refusent à pianoter une musique d’ambiance, un refrain d’actualité plus que jamais catastrophique sur toutes les chaînes de radio, de télé, sur toutes les chaînes qui me paralysent. Des morts partout, des morts violentes, bien évi- demment, à tous les étages, jusqu’au dernier où l’on ne pourra pas identifier les cadavres carbonisés. Noirs sous le noir, Afrique sans le frique, en plein Paris. Au cœur de mon dégoût, le cœur au bord des lèvres, la tête à la fenêtre pour reprendre mon souffle, à Bayonne, depuis ma planète bleue à moi, je la vois tout de même encore cette Lune qui inspira, sous mon regard stupéfait d’enfant, un si grand pas pour l’humanité. Et je décide de penser à autre chose. De digresser pour oublier cet immeuble en flammes dans la nuit. Tous ces incendies, ces bombes de chair et d’os, tous ces barreaux n’existent pas, n’existent plus si on décide de ne pas en parler, si on choisit de parler d’autres choses, de tout autre chose, de «sport» par exemple…
Il y a quatre cent trente trois mois et six jours exactement, le 20 juillet 1969, Lance Armstrong n’était même pas encore né, mais peut-être y avait-il déjà des traces d’EPO dans les tes- ticules de son père. Peut-être pas. Tout le monde s’en fout. Mon père à moi ne se dopait pas pour aller monter ses murs à mains nues, des murs comme des murailles jusqu’au ciel à mes yeux de fils admiratif. Je n’en suis pas certain mais il me semble bien qu’il a participé à la construction de cette muraille sociale de la ZUP, à Bayonne. Cette muraille que l’on n’aperçoit tout de même pas depuis la Lune. Chaque fois que je passe devant elle, les souvenirs affluent, rien que les meilleurs, bien évidemment… C’était une nuit, une nuit d’été, nous venions de faire l’acquisition de notre premier poste de télévision, et j’étais fasciné, seul sur le canapé de la salle à manger, hypnotisé par la pâleur bleutée des images de cette retransmission en directe. En Pays basque c’était la nuit, alors que de l’autre côté de l’Atlantique il devait faire grand jour, grand jour pour la fierté impérialiste des «maîtres» du Monde, jour J de la conquête de l’espace par les Américains. Les Américains avaient eu la chance de voir ces images inoubliables commentées en direct par Robert Anson Heinlein et Arthur C. Clarke. Ce devait être encore plus génial. Ça, je l’ai appris bien plus tard, évidem- ment… L’ORTF avait dû faire appel à Pierre Dumayet ou Pierre Sabagh, ou à Léon Zitrone, je n’en sais foutre rien. Mon cerveau juvénile n’a conservé aucun souvenir de ce genre, l’émotion était sûrement beaucoup trop forte pour que je puisse me concentrer ne serait-ce qu’un instant sur un aspect tout à fait périphérique de l’événement. D’ailleurs, il y a peu, j’en ai parlé avec une amie. C’est elle qui m’a suggéré les noms des animateurs de Cinq colonnes à la Une.

Maintenant, avec le recul et l’érosion des années, je crois que j’aimerais pouvoir m’en souvenir, pouvoir mettre d’autres noms sur cet événement fondateur de ma différence. Identifier les témoins en quelque sorte, des témoins vivants, ça serait mieux. En fait, si j’écris cette étrange note, ce soir, c’est probablement dans l’espoir que quelqu’un, quelque part, sur la Lune peut-être si internet va jusque là, qu’un témoin de ce 20 juillet 1969 devant l’écran unique de la télévision française lira ces lignes et saura me répondre. Léon Zitrone ou ses collègues ont-ils menti ? Les hommes ont-ils réellement un jour, celui-ci ou un autre, posé le pied sur l’astre blême de tous les poèmes ? Neil Armstrong serait-il un imposteur, un affabulateur, ou carrément un mythe ? Une des constantes paternalistes de mon géniteur aura été de nier l’authenticité des images que nous donnait à croire la télévision (que penserait-il d’internet aujourd’hui, je doute fort que cette «modernité» lui apparaîtrait plus crédible), et des exemples pour fonder son incrédulité, il pouvait en citer à la pelle, mais il se contentait toujours du même. Comment pouvait-on croire des images qui nous montraient Fernandel bien vivant dans «La vache et le prisonnier» ou dans un autre film --peu importe, c’était toujours Fernandel qui nous servait de démonstration-- alors que mon père savait bien qu’il était mort ? Il ne fallait pas lui la faire ! Je me suis toujours demandé comment papa pouvait être aussi certain du décès de Fer- nandel… mais, bien évidemment, je n’ai jamais osé l’interroger à ce propos.
Cela fait cent cinquante cinq mois et vingt deux jours qu’il est mort. Non pas Fernandel mais mon père, ça j’en ai la preuve. Je l’ai vu de mes yeux, j’ai baisé de mes lèvres sa froideur ca- davérique. Maintenant il est retourné à la glèbe, la glèbe d’un cimetière avec vue sur l’océan, tout de même. Un jour, des maçons construiront de belles maisons sur cette colline. Un de ces maçons aura peut-être un fils déçu que son père ne veuille pas partager son rêve cosmique. Un jour où il ne sera plus du tout important pour moi de savoir si les hommes ont marché sur la Lune ou non. Ce jour-là le rêve ira bien plus loin encore j’espère… Mais, ce soir, cette triste soirée du vendredi 26 août 2005, dans les décombres fumants d’un immeuble de misère, des larmes transparentes effacent mes futiles digressions. Il doit hurler son incrédulité, ce petit garçon qui a perdu ses parents la nuit dernière. À quoi bon s’en aller frimer dans le ciel alors qu’on n’a plus de toit sur la tête ! Lance Armstrong, quant à lui, il peut bien s’en aller gagner le Tour de la Lune, avec ou sans EPO, à l'angle du boulevard Vincent-Auriol et de la rue Edmond-Flamand tout le monde s’en fout !
Le plébéien bleu
22:20 Publié dans digression, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 19 juin 2005
Mission ravitaillement mortel
Puede matar*
 Comment dire cette honte ? Honte furtive toutefois mais si intense que j’aurais juré en mourir. Comment donc exprimer ce sentiment de malaise extrême sans som- brer dans la métaphore caricaturale et ridicule ? Cette impression soudaine de faire la queue comme pour entrer dans la chambre à gaz, ou au four crématoire… je me dois de dénoncer ce crime contre l’humanité, mais avec quels mots pour ne pas être tourné en dérision plus qu’à mon tour ? «Puede matar», il est écrit sur tous les paquets, sur toutes les cartouches de cigarettes. Fumer peut tuer quand on le lit en espagnol, et tue carrément, sans sommation, si on est exclu- sivement francophone. Quand les cigarettes se contentaient de nuire gravement à la santé, on en souriait encore tous, sans trop d’état d’âme ni de culpabilité, au point de récupérer, de recycler la mise en garde comme une appellation familière de plus. Après les tiges, les sèches, les clopes, voilà venues les nuit-graves sans plus de guillemets pour distancier quoi que ce soit. Mais désormais qu’elles tuent en direct, montrées du doigt dans la foule des porte-flingues anonymes, toutes les marques de cigarettes apprennent doucettement à assumer l’affichage de leur crime. Et les anciens fumeurs invétérés de tousser en souriant un peu gênés. Et les nouveaux fumeurs de sourire, moqueurs, sarcastiques intérieurs, «je ne comprends pas l’es- pagnol», qu’elle me dit la petite jeune fille que j’ai interpellée (énième victime expiatoire de mes colères irrationnelles ?) au hasard, en faisant la queue devant le comptoir de chez Eceiza à Irun. Quel âge a-t-elle, seize ? dix-huit ? vingt ans ? je ne sais même pas donner un âge. Elle est bien mignonne mais déjà elle ne m’aime pas. Ça se sent vite ces choses-là. Tout du moins moi je les sens vite. Comme mon impuissance viscérale à sauver l’humanité, je la sens vite, elle m’étreint au quotidien (qui mal étreint, honni soit-il), elle m’étouffe, j’en tousse comme si c’était moi qui fumait.
Comment dire cette honte ? Honte furtive toutefois mais si intense que j’aurais juré en mourir. Comment donc exprimer ce sentiment de malaise extrême sans som- brer dans la métaphore caricaturale et ridicule ? Cette impression soudaine de faire la queue comme pour entrer dans la chambre à gaz, ou au four crématoire… je me dois de dénoncer ce crime contre l’humanité, mais avec quels mots pour ne pas être tourné en dérision plus qu’à mon tour ? «Puede matar», il est écrit sur tous les paquets, sur toutes les cartouches de cigarettes. Fumer peut tuer quand on le lit en espagnol, et tue carrément, sans sommation, si on est exclu- sivement francophone. Quand les cigarettes se contentaient de nuire gravement à la santé, on en souriait encore tous, sans trop d’état d’âme ni de culpabilité, au point de récupérer, de recycler la mise en garde comme une appellation familière de plus. Après les tiges, les sèches, les clopes, voilà venues les nuit-graves sans plus de guillemets pour distancier quoi que ce soit. Mais désormais qu’elles tuent en direct, montrées du doigt dans la foule des porte-flingues anonymes, toutes les marques de cigarettes apprennent doucettement à assumer l’affichage de leur crime. Et les anciens fumeurs invétérés de tousser en souriant un peu gênés. Et les nouveaux fumeurs de sourire, moqueurs, sarcastiques intérieurs, «je ne comprends pas l’es- pagnol», qu’elle me dit la petite jeune fille que j’ai interpellée (énième victime expiatoire de mes colères irrationnelles ?) au hasard, en faisant la queue devant le comptoir de chez Eceiza à Irun. Quel âge a-t-elle, seize ? dix-huit ? vingt ans ? je ne sais même pas donner un âge. Elle est bien mignonne mais déjà elle ne m’aime pas. Ça se sent vite ces choses-là. Tout du moins moi je les sens vite. Comme mon impuissance viscérale à sauver l’humanité, je la sens vite, elle m’étreint au quotidien (qui mal étreint, honni soit-il), elle m’étouffe, j’en tousse comme si c’était moi qui fumait.  Fumeur passif, sauveur passif. Sauveur ou sauveteur ? Sauveteur plutôt. «Courage et dévouement**» qu’elle souri- rait, Mamour, en brandissant ses deux doigts en forme de vé. Là je surnage à peine à ce tsunami de honte, honte de ma salve d’autodéfense impromptue ; cette gamine ne m’avait rien fait, à part peut-être un peu de fumée dans les yeux, dans les narines, berk, j’ai vraiment horreur de continuer à respirer dans un tel environne- ment. Elle pourrait être ma fille si j’en avais une. Je suis sûr que ma fille fumerait exprès pour m’emmerder. Et elle sortirait avec des Jacky qui roulent en Golf GTI tunnées, 2000 watts de sono techno à donf dans le coffre, exprès pour faire chier son vieux con de père qui fait la queue devant la porte du four crématoire… Ouais, en plus elle sait parler espagnol, elle s’est bien foutue de ma gueule la morpionne. Je dis morpionne mais je pense bien pire encore. Je la surprends à sourire du coin de l’œil, à parler de quelqu’un de ridicule avec la vendeuse. Elles se moquent de moi, c’est sûr, dans la langue de Sancho Pantça avec des rires de Rossinante. Et moi j’attends bien sagement mon tour.
Fumeur passif, sauveur passif. Sauveur ou sauveteur ? Sauveteur plutôt. «Courage et dévouement**» qu’elle souri- rait, Mamour, en brandissant ses deux doigts en forme de vé. Là je surnage à peine à ce tsunami de honte, honte de ma salve d’autodéfense impromptue ; cette gamine ne m’avait rien fait, à part peut-être un peu de fumée dans les yeux, dans les narines, berk, j’ai vraiment horreur de continuer à respirer dans un tel environne- ment. Elle pourrait être ma fille si j’en avais une. Je suis sûr que ma fille fumerait exprès pour m’emmerder. Et elle sortirait avec des Jacky qui roulent en Golf GTI tunnées, 2000 watts de sono techno à donf dans le coffre, exprès pour faire chier son vieux con de père qui fait la queue devant la porte du four crématoire… Ouais, en plus elle sait parler espagnol, elle s’est bien foutue de ma gueule la morpionne. Je dis morpionne mais je pense bien pire encore. Je la surprends à sourire du coin de l’œil, à parler de quelqu’un de ridicule avec la vendeuse. Elles se moquent de moi, c’est sûr, dans la langue de Sancho Pantça avec des rires de Rossinante. Et moi j’attends bien sagement mon tour.
Heureusement je n’ai pas d’enfant. Pas d’animaux non plus. Je ne suis irresponsable que pour moi-même, c’est un moindre mal, et puis, en quelque sorte, j’ai les mains plus libres pour sauver l’humanité, non ? Surtout depuis que, moi, il y a plus de 7 ans, je me suis libéré de la tabagie. Au moins je me serais sauvé moi-même. Haie deux toits, aile ciel té de rats. Alors, hein, qu’est-ce que je fous là à subir toute la honte des 666 péchés capitaux ? Bien étrange sentiment à vrai dire, je ne dois pas être tout à fait normal. Le chevalier à la triste figure s’est-il jamais demandé si il était normal, normal par rapport à ses contemporains je veux dire ? Là j’imagine Don Quijote faisant la queue au comptoir de chez Eceiza pour acheter la dose hebdo- madaire de poison avec laquelle il tuera à petit feu et irré- médiablement sa Dulcinée. Là j’imagine Don Quijote en victime des camps d’extermination, au milieu d’une foule inconsciente et consentante. Là j’imagine Robin des Bois dévalisant un petit bureau de tabac frontalier pour alimenter la frénésie tabagique de Mamour, Maddi et Kristel. Là j’imagine un échappatoire à ma honte insupportable, à ma culpabilité atroce, à mon désir irrépressible d’Ailleurs tout de suite… et voilà que c’est mon tour. Ridiculement je me réfugie dans la satisfaction de pouvoir passer ma commande en euskara***, ridiculement aussi j’éprouve comme une satisfaction en réglant mon impôt au consumérisme le plus volatil dans la monnaie des singes européens. Et puis un immense vide se fait dans mon cerveau en tournant les talons ; je me fais l’impression de fuir, toute honte ravalée, mon fier destrier m’attend sagement.  Reprenant peu à peu conscience, je m’en vais l’enjamber théâtralement comme j’aime le faire dans les situations d’exception, silencieux et digne sous mon casque d’anonymat. Une fois de plus, j’aurais accompli ma «mis- sion» : j’appelle ça aller au ravi- taillement mortel. La vie, vraiment, parfois, ça devrait être mortel sans avoir besoin de se ravitailler sans cesse. Si Mamour pouvait imaginer ne serait-ce que le quart du dixième de ce qui se passe dans ma tête lorsque je fais la queue pour acheter ses «puede matar» !…
Reprenant peu à peu conscience, je m’en vais l’enjamber théâtralement comme j’aime le faire dans les situations d’exception, silencieux et digne sous mon casque d’anonymat. Une fois de plus, j’aurais accompli ma «mis- sion» : j’appelle ça aller au ravi- taillement mortel. La vie, vraiment, parfois, ça devrait être mortel sans avoir besoin de se ravitailler sans cesse. Si Mamour pouvait imaginer ne serait-ce que le quart du dixième de ce qui se passe dans ma tête lorsque je fais la queue pour acheter ses «puede matar» !…
Le plébéien ex-gauloises bleues
* peut tuer (en espagnol), nouveau petit nom familier pour la cigarette
** devise des sapeurs-pompiers
*** langue basque (en langue basque)
12:40 Publié dans digression, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 12 juin 2005
Un dimanche sur la terre…
...Où il ne se passerait rien
Dimanche matin post-référendaire, je me tourne et me retourne dans le lit depuis un petit moment déjà, à côté, Mamour dort encore bien joliment. J’adore l’observer dormir dans la semi obscurité. Nous avions décidé d’aller faire une ballade aujourd’hui, peut-être même marcher en montagne avec un couple d’amis, ou alors aller enrouler quelques virages avec la nouvelle Jument bleue, mais encore dans mon apnée méditative post-onirique, je me souviens que la météo d’hier nous prévoyait des orages et de la pluie pour aujourd’hui. Pourtant, du dehors me parvient une intense luminosité. Ce ne serait pas la première fois que nos météorologues nationaux se seraient enduits d’erreur en guise de protection contre les coups de soleil, et là, par la fenêtre, c’est grand soleil, grand ciel bleu, grand beau temps quoi ! Je bondis, me précipite dans les premiers vêtements qui me tombent sous la main --ceux de la veille font l’affaire-- et sprinte de ma foulée la plus féline jusqu’à la boulangerie du Boulevard d’Alsace-Lorraine afin de m’acquitter de ma principale mission dominicale : les croissants. Un plébéien bleu est très réactif, c’est d’ailleurs un de ses principaux traits de caractère.
La boulangerie est un des lieux essentiels de vie et de cohésion sociale, tout du moins dans mon quartier. Toutes les classes sociales s’y côtoient. Les SDF qui font la manche à l’entrée ne savent pas discerner l’origine des pièces jaunes et s’en foutent d’ailleurs. Du moins je le suppose, je digresse. Bref, là dans la queue j’ai senti une main se poser sur mon épaule et j’ai entendu son sourire avant de le voir. Un plébéien bleu, quoique très réactif est parfois un peu dans la Lune. Je ne l’avais pas vue, je n’avais encore vu personne d’ailleurs... Smack-smack, les bises claquent, c’est Maddi. Son sourire est comme tatoué sur son visage et ça lui va bien. Elle aussi a bondi en voyant le grand beau temps à sa fenêtre. Et en ce dimanche matin où il ne s’est encore rien passé sur Terre, pour Maddi c’est programme plage. À la boulangerie, elle fait la queue pour acheter une bouteille d’eau à emporter. Bref, rien ne presse, Mamour doit dormir encore, il est tôt, nous décidons d’aller boire un café ensemble à la terrasse du Balto. C’est à deux pas, à deux bonds devrais-je dire tant nous voici tout deux bondissants tels des Basques contents d’ignorer la victoire du B.O. au championnat de France de rugby.
Petite parenthèse sur cette «info» futile et inintéressante : Alors que nous étions bien installés en terrasse à déguster nos cafés, un camion de supporters biarrots hystériques est passé avec la sono à fond qui vociférait du «Aupa B.O.». Je n’avais encore jamais eu l’heur d’entendre cette foutue rengaine qui leur sert d’hymne, mais alors là, non, c’est grave, superlativement nul et désespérant. Le genre de truc qui me fout tout de suite en rogne, mais alors tout de suite. Et puis y’a aussi que je désespère très vite de l’humanité, pour un oui ou pour un non, faut avouer. Je viens de le dire, un plébéien bleu c’est hyper réactif, et en l’occurrence ça insulte à tours de bras tout ce qui bouge avec un drapeau rouge et blanc à la main. Faut dire qu’ils s’époumonaient un peu dans le vide et l’indifférence ambiante, je rappelle que nous étions boulevard d’Alsace-Lorraine… à Bayonne. Mais ça ne semblait aucunement refroidir leurs ardeurs qui ne pouvaient qu’évoluer crescendo malgré mes «bande d’abrutis» et autres doigts provocateurs, malheureusement… Après, d’un côté, je me dis, et s’ils m’avaient entendu, et s’ils s’étaient arrêtés, et s’ils étaient descendus de leur camion, hum, j’aurais probablement été assez con pour ne pas m’enfuir et me laisser casser la gueule… Ça finira par m’arriver un de ces quatre. J’ai eu encore du bol ce dimanche matin, il faisait si beau temps tandis que Mamour devait espérer son petit déjeuner : «Alors, les croissants, ça vient ?», fermons la parenthèse.
 Il est onze heures et quelques, un croissant se noie dans le thé brûlant avant de se faire déchirer d’un coup de dents rageur. La journaliste de France Inter vient d’annoncer la nouvelle unique et «énaurme» qui alimentera tout son bulletin d’information et les suivants durant au moins quarante-huit heures. Sur toutes les radios, dans toutes les télévisions on ne parle et parlera plus que de ça. Le plébéien bleu est également explosif, faut faire extrêmement gaffe en essayant de manipuler ces grosses choses-là. Et que je trépigne, et que je fulmine, et que j’enrage. Mamour, elle, est zen. Pas complètement réveillée non plus, faut dire. Ça aide à conserver sa zénitude. Les croissants sont déjà presque complètement rongés par l’acide au creux de mon estomac, Kriss a pris le relais dans son «dimanche par hasard» et tente de nous faire partager cette même et unique émotion possible à cette heure et sur cette planète… je n’en crois pas ce qui me reste d’indépendance et de jugeote entre les oreilles. Désormais, nos «élites» et leurs serviles relais médiatiques l’ont décrété, l’émotion sera unique et o-bli-ga-toire. Et pour ce faire, on prendra bien soin d’effacer toute interférence, il n’y aura pas d’autre actualité possible. Il ne se passe rien sur Terre pendant qu’on nous invite, à longueurs de flashs et d’émissions spéciales, à communier avec l’«élite». Tous les «citoyens» consommateurs d’information se doivent de partager cette même joie «énaurme» qui remplit tout. En ce dimanche de liesse unanime, il n’y a pas eu de série d’attentats en Iran. Ni un, ni dix, ni cent morts : aucun. Aucun mort non plus dans ce train qui n’a pas déraillé suite à une explosion sur la ligne entre Moscou et Grozny en Tchétchénie. Les Italiens n’ont pas voté ce dimanche, même pas à moins de 30 %, jamais on a voulu les consulter sur un sujet de société aussi brûlant que la bioéthique, et jamais l’église catholique n’est intervenue dans le débat. Jamais non plus, en ce dimanche d’orgasme journalistique généralisé, les ministres des Finances du G8 n’ont envisagé d’annuler la dette de 18 pays parmi les plus pauvres de la planète. Jamais leurs homologues européens aux Affaires étrangères n’ont discuté du budget de l’UE pour la période allant de 2007 à 2013, d’ailleurs, s’ils l’avaient fait, qui cela aurait-il intéressé ? Il n’y a pas eu non plus de réunion à Madrid entre les ministres de la Culture de 70 pays pour remettre en cause la marchandisation de la culture. Ce dimanche matin, le port de Bayonne n’a pas été bloqué par des pêcheurs d’anchois. Comme il ne se passe rien de rien, pas même dans les commissariats où des militants basques prétendent avoir été torturés, il ne sera pas possible de donner crédit à des assertions inexistantes qui accuseraient la France d’être acteur dans cette politique tortionnaire menée par l’Espagne. Et puis surtout, sur les ondes de France Inter, à partir de 11 heures en ce dimanche matin d’«énaurmité», même le rugby était devenu hors sujet et le Biarritz Olympique n’avait jamais emporté le bouclier de Brénus.
Il est onze heures et quelques, un croissant se noie dans le thé brûlant avant de se faire déchirer d’un coup de dents rageur. La journaliste de France Inter vient d’annoncer la nouvelle unique et «énaurme» qui alimentera tout son bulletin d’information et les suivants durant au moins quarante-huit heures. Sur toutes les radios, dans toutes les télévisions on ne parle et parlera plus que de ça. Le plébéien bleu est également explosif, faut faire extrêmement gaffe en essayant de manipuler ces grosses choses-là. Et que je trépigne, et que je fulmine, et que j’enrage. Mamour, elle, est zen. Pas complètement réveillée non plus, faut dire. Ça aide à conserver sa zénitude. Les croissants sont déjà presque complètement rongés par l’acide au creux de mon estomac, Kriss a pris le relais dans son «dimanche par hasard» et tente de nous faire partager cette même et unique émotion possible à cette heure et sur cette planète… je n’en crois pas ce qui me reste d’indépendance et de jugeote entre les oreilles. Désormais, nos «élites» et leurs serviles relais médiatiques l’ont décrété, l’émotion sera unique et o-bli-ga-toire. Et pour ce faire, on prendra bien soin d’effacer toute interférence, il n’y aura pas d’autre actualité possible. Il ne se passe rien sur Terre pendant qu’on nous invite, à longueurs de flashs et d’émissions spéciales, à communier avec l’«élite». Tous les «citoyens» consommateurs d’information se doivent de partager cette même joie «énaurme» qui remplit tout. En ce dimanche de liesse unanime, il n’y a pas eu de série d’attentats en Iran. Ni un, ni dix, ni cent morts : aucun. Aucun mort non plus dans ce train qui n’a pas déraillé suite à une explosion sur la ligne entre Moscou et Grozny en Tchétchénie. Les Italiens n’ont pas voté ce dimanche, même pas à moins de 30 %, jamais on a voulu les consulter sur un sujet de société aussi brûlant que la bioéthique, et jamais l’église catholique n’est intervenue dans le débat. Jamais non plus, en ce dimanche d’orgasme journalistique généralisé, les ministres des Finances du G8 n’ont envisagé d’annuler la dette de 18 pays parmi les plus pauvres de la planète. Jamais leurs homologues européens aux Affaires étrangères n’ont discuté du budget de l’UE pour la période allant de 2007 à 2013, d’ailleurs, s’ils l’avaient fait, qui cela aurait-il intéressé ? Il n’y a pas eu non plus de réunion à Madrid entre les ministres de la Culture de 70 pays pour remettre en cause la marchandisation de la culture. Ce dimanche matin, le port de Bayonne n’a pas été bloqué par des pêcheurs d’anchois. Comme il ne se passe rien de rien, pas même dans les commissariats où des militants basques prétendent avoir été torturés, il ne sera pas possible de donner crédit à des assertions inexistantes qui accuseraient la France d’être acteur dans cette politique tortionnaire menée par l’Espagne. Et puis surtout, sur les ondes de France Inter, à partir de 11 heures en ce dimanche matin d’«énaurmité», même le rugby était devenu hors sujet et le Biarritz Olympique n’avait jamais emporté le bouclier de Brénus.
Quand il ne se passe rien comme ça, moi, faut que j’invente. Que je m’invente un monde, un autre monde qui serait possible, un monde avec de belles routes viroleuses où poser les roues de ma Jument bleue pour y jouer à rester vivants à deux. Oui Mamour, nous irons nous balader à moto, si tu veux bien… une fois que je me serais un peu calmé…
Tu m’as conseillé de leur écrire, à France Inter, pour me défouler un peu, et ça m’a calmé. Tu as eu raison, comme très souvent, et j’ai probablement eu tort de haïr Florence Aubenas en ce dimanche matin si joliment ensoleillé.
Le bleu et blanc plébéien
13:45 Publié dans digression, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 06 juin 2005
Mon Pays basque bisque rage !
Idigoras est mort,
pas moi !
 D’une manière générale, le ouèbe se fout bien pas mal du Pays basque. Ce vendredi 3 juin, sur le ouèbe francophone, je n’ai trouvé que deux sites suisses pour rendre compte du décès de Jon Idigoras. Hormis, bien entendu, les sites basques engagés. Toute la France se fout bien des emphysèmes emportant à 69 ans les militants et patriotes basques ; à droite ou à gauche, en haut ou en bas, le citoyen internaute de langue française n’avait peut-être même jamais lu ou vu quoi que ce soit concernant cet homme à l’abord bourru mais chaleureux. En fait, très probablement, de ce côté-ci du «clavier azerty», je dois être le seul à avoir songé à mettre les drapeaux en berne en guise de deuil. J’espérerais bien un démenti, mais, malheureusement, il n’y en aura pas… Drôle d’idée tout de même que de se mettre en berne pour Jon Idigoras, que de se proclamer en deuil ou de décréter, heu, disons au moins trois quarts d’heure de bordel tonitruant mais respectueux en son honneur.
D’une manière générale, le ouèbe se fout bien pas mal du Pays basque. Ce vendredi 3 juin, sur le ouèbe francophone, je n’ai trouvé que deux sites suisses pour rendre compte du décès de Jon Idigoras. Hormis, bien entendu, les sites basques engagés. Toute la France se fout bien des emphysèmes emportant à 69 ans les militants et patriotes basques ; à droite ou à gauche, en haut ou en bas, le citoyen internaute de langue française n’avait peut-être même jamais lu ou vu quoi que ce soit concernant cet homme à l’abord bourru mais chaleureux. En fait, très probablement, de ce côté-ci du «clavier azerty», je dois être le seul à avoir songé à mettre les drapeaux en berne en guise de deuil. J’espérerais bien un démenti, mais, malheureusement, il n’y en aura pas… Drôle d’idée tout de même que de se mettre en berne pour Jon Idigoras, que de se proclamer en deuil ou de décréter, heu, disons au moins trois quarts d’heure de bordel tonitruant mais respectueux en son honneur.
Le pire c’est que ça ne l’aurait même pas amusé, tout le contraire même, peut-être, je ne suis pas sûr… peut-être qu’en vieillissant, hum, je ne sais pas, peut-être ? Bref, ce n’est pas que je cultive une quelconque affection à l’adresse de Jon Idigoras maintenant que le voici mort, guère plus que de son vivant, mais encore sous l’émotion de l’annonce de sa disparition j’ai bien envie de l’inscrire à mon Panthéon privatif. Un Panthéon dont je n’avais encore jamais causé à quiconque, tout du moins en ces termes. Probablement parce que je n’avais pas même la conscience de sa possible existence. Peut-être n’est-il que furtif ? Ou virtuel ? Ça serait bien la mode ici ! Toujours est-il qu’il n’a qu’un seul étage et pas de vitrine, pas le moindre parking souterrain, ni catacombe, et surtout aucun ascenseur. L’échafaud n’est pas aboli dans la rancœur et la haine des anti-basques, alors gaffe. Mon Panthéon à moi que j’ai aujourd’hui, il est en rez-de-chaussée et sans même un toit à se mettre sur le cadavre. Quasi-pathétique. En fait, Jon Idigoras, je l’ai très peu connu personnellement. Et pas du tout intimement. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, ni de près ni de loin, et je vous suppute majoritaires parmi les lecteurs du plébéien bleu, j’ai mis en liens quelques sites causant de lui, de sa vie, son œuvre, tout ça. La plupart sont en espagnol, désolé ! q:o/ Voilà… que disais-je ?
Oui, assez pathétique ce souvenir dans ma mémoire toujours aussi confuse (un de ces quatre il faudra que je tente d’analyser les troubles récurrents de ma mémoire, psy-machinchose range ton portefeuille, c’est la mienne !), pathétique cette image où il tient le bout du comptoir à la Conso, entouré de sa garde rapprochée, entre deux attaques du GAL, un verre de Montilla à la main. J’interprète son regard dans le mien comme animé par la haine, et moi je baisse les yeux. Ça serait vraiment très long à expliquer tout ça, tout ces sentiment contradictoires qui m’habitaient alors et me visitent encore cycliquement. Lui, le député de Herri Batasuna, il était bien entendu une cible de choix pour les tueurs appointés par le terrorisme d’État.  Moi aussi, à l’époque, j’étais menacé par ces mêmes porte-flingues, tout du moins me le figurais-je en faisant quotidiennement et paranoïaquement le tour de mon véhicule chaque fois avant d’y monter. Nous participions ensemble aux mêmes manifestations de dénonciations, aux mêmes obsèques à répétition. Pour les ennemis du peuple basque, nous figurions sur la même liste des gêneurs à abattre, lui en tête, moi en queue, mais au-dessus de sa moustache-barricade, ses yeux me mitraillaient chaque fois qu’ils me voyaient. Les miens l’ont-ils aussi mitraillé par défi et par dépit, je ne le sais plus ? Peut-être. Qu’importe ! Il est décédé ce vendredi 3 juin sans que je n’aie jamais eu la chance de lui serrer la main.
Moi aussi, à l’époque, j’étais menacé par ces mêmes porte-flingues, tout du moins me le figurais-je en faisant quotidiennement et paranoïaquement le tour de mon véhicule chaque fois avant d’y monter. Nous participions ensemble aux mêmes manifestations de dénonciations, aux mêmes obsèques à répétition. Pour les ennemis du peuple basque, nous figurions sur la même liste des gêneurs à abattre, lui en tête, moi en queue, mais au-dessus de sa moustache-barricade, ses yeux me mitraillaient chaque fois qu’ils me voyaient. Les miens l’ont-ils aussi mitraillé par défi et par dépit, je ne le sais plus ? Peut-être. Qu’importe ! Il est décédé ce vendredi 3 juin sans que je n’aie jamais eu la chance de lui serrer la main.
Cette année, manifestement, j’ai un réel problème avec mes deuils. Je ne sais pas les identifier. D’aucuns penseraient que je fais ici le deuil de ma jeunesse perdue ou de mes idées politiques patriotiques et basques… et révolutionnaires… et rouges, oui, et rouges. Que nenni. Le rouge c’est aussi la couleur des enragés et le plébéien bleu est aujourd’hui tout rouge de cette rage qui lui donne si bon teint. Oui, j’enrage parce que Jon Idigoras est mort, et le peuple basque est bien loin d’être libéré, émancipé, autodéterminé, indépendant, ou comme on voudra, mais je crains que les choses n’aient guère avancé politiquement en Pays basque ces vingt dernières années. La déchirure au sein de notre peuple est plus large que jamais, les plaies encore plus profondes et nombreuses, le peuple espagnol nous hait comme jamais et les Français nous ignorent de plus en plus ostensiblement, ou alors si ils ne nous ignorent pas, ils font comme les Espagnols, ils nous haïssent.
J’enrage d’impuissance. Même entre Basques nous continuons à nous entre-haïr et pas souvent cordialement. Là non plus, les choses n’ont pas avancé. Et j’ai même peur que des dizaines de milliers d’Idigoras mitraillent encore du regard des dizaines de milliers d’anti-Idigoras qui le leur rendent bien. Et même dans le dos, comme des lâches, eux…  Et pire encore que tout, je me dis que ce sont finalement tous ces milliers de deuils virtuels qui ont obscurci et obscurcissent toujours et peut-être encore pour des décennies l’horizon si verdoyant du Pays basque des poètes. Putain, où ai-je foutu cette maudite gomme à déterrer les vivants, où ai-je mis cette volonté gramscienne d'optimisme qui seule sait tempérer le pessimisme de la raison, tout ça, patin couffin ? J’enrage. Ils étaient des centaines de milliers d’Espagnols à manifester à Madrid pour que l’on continue à bouffer du Basque ad vitam aeternam et jusqu’à ce que mort s’en suive. Et Idigoras est mort. Merde ! Y’en a marre !...
Et pire encore que tout, je me dis que ce sont finalement tous ces milliers de deuils virtuels qui ont obscurci et obscurcissent toujours et peut-être encore pour des décennies l’horizon si verdoyant du Pays basque des poètes. Putain, où ai-je foutu cette maudite gomme à déterrer les vivants, où ai-je mis cette volonté gramscienne d'optimisme qui seule sait tempérer le pessimisme de la raison, tout ça, patin couffin ? J’enrage. Ils étaient des centaines de milliers d’Espagnols à manifester à Madrid pour que l’on continue à bouffer du Basque ad vitam aeternam et jusqu’à ce que mort s’en suive. Et Idigoras est mort. Merde ! Y’en a marre !...
J’aurais bien bu un Montilla, mais on n’en trouve plus de ce côté-ci de la frontière. Désolant.
Le plébéien bleu
20:55 Publié dans digression, écrits sur fond bleu, politique | Lien permanent | Commentaires (3)
vendredi, 20 mai 2005
"Il est chié ce vent...
...C'est lui qui fume ma cigarette"
Très grand beau temps hier sur la Côte basque - stop - aujourd'hui suis rouge comme une écrevisse - stop - mais je retourne quand même pic-niquer sur la plage - stop
Suis même allé me baigner - stop - petit vent doux - stop - un peu peur des baïnes - stop - mais géniale première fois de l'année - stop - j'y retourne cet aprèm' - stop - la vie est belle - jamais plus stop
le plébéien bleu
07:10 Publié dans écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 04 mai 2005
Anticonstitutionnellement
Anticonstitutionnellement
Anticonstitutionnellement
Anticonstitutionnellement
Anticonstitutionnellement
Bon, je l'ai placé, mais je ne suis pas certain que cela fera avancer les choses... ça ne les fera pas reculer non plus, y'a pas de raison. Hum ! En espérant toutefois que certains ne prendront pas ce simple "relevage" de défi pour une provocation.
Le plébéien bleu
23:10 Publié dans écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 31 mars 2005
Les ennemis étoilés :
film résistant et d'amour
 D’un côté de l’Adour, au sud, les ennemis de la version originale, les marchands de pop-corn à huit euros, les distributeurs de publicité hurlante, les promoteurs de la croissance infinie et toute la planète Hollywood. Et pas une seule tête qui dépasse. Au sud de l’Adour il y a cette mairie de droit divin avec vue sur l’hôpital qui se fout de la charité. Et cette fac de droit comme un i avec sa chaire de dictateur d’avant la guerre des boutons. Et puis aussi cette toute petite librairie peinte en vert avec des pentes partout. Ce sont eux les ennemis étoilés. Ce sont eux qui envoient les huissiers réveiller à l’aube les érémistes et les salariés précaires en grève, ces huissiers qui font s’enfuir les chattes qui boivent aux robinets et terrorisent les femmes enceintes. Ces huissiers vêtus de tristesse pour contrôler la solidité des chaînes aux grilles cadenassées du cinéma de quartier. Je les hais, ces huissiers, presque autant que j’aime cet Atalante qui amarre son écran unique au rivage nord de l’Adour. Le cinéma c’est la vie qu’ils disaient ! Et moi je me suis repris à aimer la vie depuis que j’ai su reconnaître les feux bleus de la résistance dans ses yeux qui illuminent désormais toutes mes soirées cinéphiles. Je me suis repris à aimer tous les petits et les sans grades qui résistent aux géants étoilés...
D’un côté de l’Adour, au sud, les ennemis de la version originale, les marchands de pop-corn à huit euros, les distributeurs de publicité hurlante, les promoteurs de la croissance infinie et toute la planète Hollywood. Et pas une seule tête qui dépasse. Au sud de l’Adour il y a cette mairie de droit divin avec vue sur l’hôpital qui se fout de la charité. Et cette fac de droit comme un i avec sa chaire de dictateur d’avant la guerre des boutons. Et puis aussi cette toute petite librairie peinte en vert avec des pentes partout. Ce sont eux les ennemis étoilés. Ce sont eux qui envoient les huissiers réveiller à l’aube les érémistes et les salariés précaires en grève, ces huissiers qui font s’enfuir les chattes qui boivent aux robinets et terrorisent les femmes enceintes. Ces huissiers vêtus de tristesse pour contrôler la solidité des chaînes aux grilles cadenassées du cinéma de quartier. Je les hais, ces huissiers, presque autant que j’aime cet Atalante qui amarre son écran unique au rivage nord de l’Adour. Le cinéma c’est la vie qu’ils disaient ! Et moi je me suis repris à aimer la vie depuis que j’ai su reconnaître les feux bleus de la résistance dans ses yeux qui illuminent désormais toutes mes soirées cinéphiles. Je me suis repris à aimer tous les petits et les sans grades qui résistent aux géants étoilés...  Hier, j’ai fermé ma pompe plus tôt pour passer au Champion. Sur le trottoir devant l’Atalante, il y avait leur petite table de camping où j’ai déposé ma solidarité : une boite de chocolats. Et ce soir, j’y suis remonté. Ma Jument bleue connaît maintenant la route par cœur. Sans même réfléchir, j’ai accepté son invitation fraternelle. La lutte se doit d’être joyeuse et fraternelle.
Hier, j’ai fermé ma pompe plus tôt pour passer au Champion. Sur le trottoir devant l’Atalante, il y avait leur petite table de camping où j’ai déposé ma solidarité : une boite de chocolats. Et ce soir, j’y suis remonté. Ma Jument bleue connaît maintenant la route par cœur. Sans même réfléchir, j’ai accepté son invitation fraternelle. La lutte se doit d’être joyeuse et fraternelle.  Avant la grande fête de la résistance au Boucau, les salariés en grève mangent ensemble, et là, je suis avec eux dans ce restaurant du quartier. Et là, tout sourire, elle m’indique la chaise, face à elle…
Avant la grande fête de la résistance au Boucau, les salariés en grève mangent ensemble, et là, je suis avec eux dans ce restaurant du quartier. Et là, tout sourire, elle m’indique la chaise, face à elle…
Bayonne, le 23 novembre 2002 à 20 heures.
Le plébéien bleu de nuit
20:45 Publié dans écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)