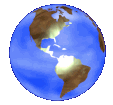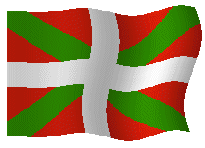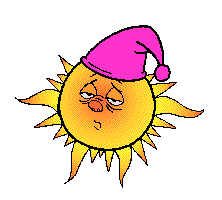« 2005-07 | Page d'accueil
| 2005-09 »
vendredi, 26 août 2005
Ils ont incendié l’astre des poètes
Et Armstrong n’aurait pas
marché sur la Lune
Voilà cinq mois que j’écris plus ou moins irrégulièrement sur ce si joli blog tout bleu, bleu comme la planète bleue, cette glèbe bleue commune à toutes les plèbes, y compris la plèbe basque ou bayonnaise, bien évidemment… Cinq mois de coups de gueule et de coups de cœur, cinq mois de digressions, d’essais sur la diversité de l’art ou du vulgaire, de petits délires person- nels parfois, cinq mois pendant lesquels j’ai osé une toujours incertaine exhibition des mots et des sentiments au travers de plusieurs tentatives littéraires ou poétiques, cinq mois et un jour exactement. Aujourd’hui, vendredi 26 août 2005, j’ose avouer, exhiber un gros coup de blues –passager, il faut l’espérer--, un gros bleu à l’âme, une sorte d’ecchymose cervicale, une es- pèce de tristesse majeure, un dégoût. Aujourd’hui, je cache ma langue toute bleue dans ma bouche, derrière mes dents qui sont tellement frustrées de ne pouvoir mordre, derrière mes lèvres en manque, en manque des lèvres de Mamour qui rentrera sûrement bien tard ce soir. Olivier Baratchart l’a affirmé, les taureaux qu’il vient d’aller chercher à Salamanque ne sont pas atteints par l’épidémie de la langue bleue, non transmissible à l’homme. Je n’irai jamais voir une de ses foutues corridas criminelles et sadiques, bien évidemment… mais j’ai quand même la langue toute bleue. La langue et les doigts. Mes doigts tout bleus sur le clavier tout noir, mes doigts révoltés qui se refusent à pianoter une musique d’ambiance, un refrain d’actualité plus que jamais catastrophique sur toutes les chaînes de radio, de télé, sur toutes les chaînes qui me paralysent. Des morts partout, des morts violentes, bien évi- demment, à tous les étages, jusqu’au dernier où l’on ne pourra pas identifier les cadavres carbonisés. Noirs sous le noir, Afrique sans le frique, en plein Paris. Au cœur de mon dégoût, le cœur au bord des lèvres, la tête à la fenêtre pour reprendre mon souffle, à Bayonne, depuis ma planète bleue à moi, je la vois tout de même encore cette Lune qui inspira, sous mon regard stupéfait d’enfant, un si grand pas pour l’humanité. Et je décide de penser à autre chose. De digresser pour oublier cet immeuble en flammes dans la nuit. Tous ces incendies, ces bombes de chair et d’os, tous ces barreaux n’existent pas, n’existent plus si on décide de ne pas en parler, si on choisit de parler d’autres choses, de tout autre chose, de «sport» par exemple…
Il y a quatre cent trente trois mois et six jours exactement, le 20 juillet 1969, Lance Armstrong n’était même pas encore né, mais peut-être y avait-il déjà des traces d’EPO dans les tes- ticules de son père. Peut-être pas. Tout le monde s’en fout. Mon père à moi ne se dopait pas pour aller monter ses murs à mains nues, des murs comme des murailles jusqu’au ciel à mes yeux de fils admiratif. Je n’en suis pas certain mais il me semble bien qu’il a participé à la construction de cette muraille sociale de la ZUP, à Bayonne. Cette muraille que l’on n’aperçoit tout de même pas depuis la Lune. Chaque fois que je passe devant elle, les souvenirs affluent, rien que les meilleurs, bien évidemment… C’était une nuit, une nuit d’été, nous venions de faire l’acquisition de notre premier poste de télévision, et j’étais fasciné, seul sur le canapé de la salle à manger, hypnotisé par la pâleur bleutée des images de cette retransmission en directe. En Pays basque c’était la nuit, alors que de l’autre côté de l’Atlantique il devait faire grand jour, grand jour pour la fierté impérialiste des «maîtres» du Monde, jour J de la conquête de l’espace par les Américains. Les Américains avaient eu la chance de voir ces images inoubliables commentées en direct par Robert Anson Heinlein et Arthur C. Clarke. Ce devait être encore plus génial. Ça, je l’ai appris bien plus tard, évidem- ment… L’ORTF avait dû faire appel à Pierre Dumayet ou Pierre Sabagh, ou à Léon Zitrone, je n’en sais foutre rien. Mon cerveau juvénile n’a conservé aucun souvenir de ce genre, l’émotion était sûrement beaucoup trop forte pour que je puisse me concentrer ne serait-ce qu’un instant sur un aspect tout à fait périphérique de l’événement. D’ailleurs, il y a peu, j’en ai parlé avec une amie. C’est elle qui m’a suggéré les noms des animateurs de Cinq colonnes à la Une.

Maintenant, avec le recul et l’érosion des années, je crois que j’aimerais pouvoir m’en souvenir, pouvoir mettre d’autres noms sur cet événement fondateur de ma différence. Identifier les témoins en quelque sorte, des témoins vivants, ça serait mieux. En fait, si j’écris cette étrange note, ce soir, c’est probablement dans l’espoir que quelqu’un, quelque part, sur la Lune peut-être si internet va jusque là, qu’un témoin de ce 20 juillet 1969 devant l’écran unique de la télévision française lira ces lignes et saura me répondre. Léon Zitrone ou ses collègues ont-ils menti ? Les hommes ont-ils réellement un jour, celui-ci ou un autre, posé le pied sur l’astre blême de tous les poèmes ? Neil Armstrong serait-il un imposteur, un affabulateur, ou carrément un mythe ? Une des constantes paternalistes de mon géniteur aura été de nier l’authenticité des images que nous donnait à croire la télévision (que penserait-il d’internet aujourd’hui, je doute fort que cette «modernité» lui apparaîtrait plus crédible), et des exemples pour fonder son incrédulité, il pouvait en citer à la pelle, mais il se contentait toujours du même. Comment pouvait-on croire des images qui nous montraient Fernandel bien vivant dans «La vache et le prisonnier» ou dans un autre film --peu importe, c’était toujours Fernandel qui nous servait de démonstration-- alors que mon père savait bien qu’il était mort ? Il ne fallait pas lui la faire ! Je me suis toujours demandé comment papa pouvait être aussi certain du décès de Fer- nandel… mais, bien évidemment, je n’ai jamais osé l’interroger à ce propos.
Cela fait cent cinquante cinq mois et vingt deux jours qu’il est mort. Non pas Fernandel mais mon père, ça j’en ai la preuve. Je l’ai vu de mes yeux, j’ai baisé de mes lèvres sa froideur ca- davérique. Maintenant il est retourné à la glèbe, la glèbe d’un cimetière avec vue sur l’océan, tout de même. Un jour, des maçons construiront de belles maisons sur cette colline. Un de ces maçons aura peut-être un fils déçu que son père ne veuille pas partager son rêve cosmique. Un jour où il ne sera plus du tout important pour moi de savoir si les hommes ont marché sur la Lune ou non. Ce jour-là le rêve ira bien plus loin encore j’espère… Mais, ce soir, cette triste soirée du vendredi 26 août 2005, dans les décombres fumants d’un immeuble de misère, des larmes transparentes effacent mes futiles digressions. Il doit hurler son incrédulité, ce petit garçon qui a perdu ses parents la nuit dernière. À quoi bon s’en aller frimer dans le ciel alors qu’on n’a plus de toit sur la tête ! Lance Armstrong, quant à lui, il peut bien s’en aller gagner le Tour de la Lune, avec ou sans EPO, à l'angle du boulevard Vincent-Auriol et de la rue Edmond-Flamand tout le monde s’en fout !
Le plébéien bleu
22:20 Publié dans digression, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)
Dopo Mezzanotte :
Hommage du cinéma au cinéma
Un piccolo gioiello*
Imaginez un film qui se déroulerait à l’intérieur d’une toute peti- te pièce de monnaie, une pièce de 2 cents d’euro italienne, sur l’avers, plus précisément. Sur l’emblématique tour turinoise, le Môle d’Antonelli, une suite de panneaux avec de drôle de chif- fres, c’est la fameuse «suite de Fibonacci». Cette tour d’où Amanda contemple la ville qu’elle semble ne pas reconnaître --et ce n’est absolument pas un hasard de la mise en scène mais dans cette tour réside toute la portée symbolique de ce petit joyau de film, le Môle accueille désormais le «Musée national du cinéma»--, c’est le domaine de Quasimodo, un Quasimodo ita- lien bien évidemment, donc forcément beau. Forcément beau et poète, Martino est le gardien de nuit du musée.  Son Esméralda, il l’a filmée à la sortie du bus qui la mè- ne travailler, puis derrière la vitre du fast- food où elle attend tous les soirs de pou- voir fermer la boutique juste avant minuit, l’heure fatidique à laquelle son bus du re- tour sera le dernier, il l’a filmée partout où il peut la voir vivre afin d’en faire l’hé- roïne de son film qu’il fabrique à petits coups de manivelle de cette machine à remonter jusqu’à ce temps originel où le cinéma n'avait pas besoin de paroles. Dopo Mezanotte c’est avant tout une très jolie histoire d’amour et de cinéma et de jeunesse et d’espoir et d’Italie du nord et du Monde en 2004, tout ça de par la magie du format Panavision qui permet encore de rêver les yeux grands ouverts dans un fauteuil de cinéma. Dopo Mezzanotte c’est aussi un Ange qui passe -–et qui meurt forcément à la fin-- dans le vacarme de nos vies. Dopo Mezzanotte est le petit bijou cinématogra- phique de cette rentrée à l’Autre cinéma. Imaginez ! Imaginez un cinéma ouvert après minuit sur une berge de l’Adour ! Et des bus urbains circulant toute la nuit ! Imaginez que c’est vous le héros du film et que vous embrassez votre amoureuse au sommet de la plus haute tour de la ville ! Plus besoin d’imaginer que vous êtes Buster Keaton !... Imaginez que le nombre des entrées suive la logique de Fibonacci et qu’il fasse de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946... spectateurs ravis et charmés, en toute lo- gique, pour saluer et goûter ce si poétique hommage du cinéma au cinéma !
Son Esméralda, il l’a filmée à la sortie du bus qui la mè- ne travailler, puis derrière la vitre du fast- food où elle attend tous les soirs de pou- voir fermer la boutique juste avant minuit, l’heure fatidique à laquelle son bus du re- tour sera le dernier, il l’a filmée partout où il peut la voir vivre afin d’en faire l’hé- roïne de son film qu’il fabrique à petits coups de manivelle de cette machine à remonter jusqu’à ce temps originel où le cinéma n'avait pas besoin de paroles. Dopo Mezanotte c’est avant tout une très jolie histoire d’amour et de cinéma et de jeunesse et d’espoir et d’Italie du nord et du Monde en 2004, tout ça de par la magie du format Panavision qui permet encore de rêver les yeux grands ouverts dans un fauteuil de cinéma. Dopo Mezzanotte c’est aussi un Ange qui passe -–et qui meurt forcément à la fin-- dans le vacarme de nos vies. Dopo Mezzanotte est le petit bijou cinématogra- phique de cette rentrée à l’Autre cinéma. Imaginez ! Imaginez un cinéma ouvert après minuit sur une berge de l’Adour ! Et des bus urbains circulant toute la nuit ! Imaginez que c’est vous le héros du film et que vous embrassez votre amoureuse au sommet de la plus haute tour de la ville ! Plus besoin d’imaginer que vous êtes Buster Keaton !... Imaginez que le nombre des entrées suive la logique de Fibonacci et qu’il fasse de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946... spectateurs ravis et charmés, en toute lo- gique, pour saluer et goûter ce si poétique hommage du cinéma au cinéma !
Imaginons !
Robinson Crusoé
*un petit bijou
16:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 20 août 2005
Du passé je me fais la boule à zéro
Ma coiffeuse
n’aime pas la pluie
Depuis la fin des fêtes de Bayonne et surtout suite à quelques commentaires sur le blog de Boris à propos du bilan «assumé» par le maire, je m’étais dit que, moi aussi, il faudrait que j’inter- roge mon coiffeur… ou plutôt ma coiffeuse. En fait c’était surtout une manière de me dire à moi-même qu’il ne fallait plus trop que je tarde, que les oreilles couvertes style Droopy ça ne sied guère à un plébéien même plus trop bleu. Ça m’énerve d’avoir les cheveux sur les oreilles, comme beaucoup d’autres choses en cette période d’ailleurs. Les vacances c’est énervant, à for- ce… Bref, je n’ai pas pris rendez-vous, comme d’hab’, j’ai juste posé la moto devant le salon, j’ai regardé au travers de la vitri- ne --une seule bonne femme la tête sous un casque feuilletant distraitement Gala tandis que je retirais le mien et y glissais mes gants— et j’ai dit bonjour à la dame en poussant la porte, bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, pouvez-vous me couper les cheveux, là, maintenant, s’il vous plait, tout sourire, tout poli, tout quémandeur comme j’ai horreur de l’être. Elle m’a répondu par un sourire, poliment ou/et commercialement, la demoiselle que je ne reconnaissais pas comme ma coiffeuse habituelle (j’ai toujours aimé avoir des habitudes). Ce n’était pas Caroline… Elle m’a aussi répondu que, oui, c’était possible, elle me prendrait, d’ici dix minutes disons mais elle ne m’a rien dit à propos de ses fêtes de Bayonne à elle ou de celles de ses clients. Pas le moindre commentaire, ni en bien ni en mal et je me rappelle que, sur le moment, j’ai un peu bloqué. Mon sou- rire se crispant naturellement, avant de tourner les talons et de refranchir la porte pour aller acheter un journal quelconque à la librairie voisine, je me suis mangé les lèvres. J’avais trop envie de lui demander si elle était au courant pour le mort de la rue Daniel Argote, le premier soir des fêtes, si elle avait entendu quelque chose, si elle savait qui il était, comment il était mort, qui l’avait tué, assassiné peut-être, pourquoi et si même c’était tout simplement vrai qu’il y avait eu un mort à la sortie du bar des Amis… mais je n’ai rien dit de tel, j’ai juste répondu «à tout de suite», toujours en souriant, m’appliquant un peu à effacer ma crispation maladive.
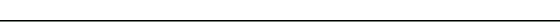
Douze minutes plus tard j’étais de retour, le Canard enchaîné sous le bras et le boulet dans la gorge. Vous en avez vu beau- coup, des flics, dans les rues, durant les fêtes ? Vous les avez reconnus dans leur uniforme de «festayre» ?... Ces questions gravées sur mon front, personne n’aurait pu les lire, bien évi- demment, à cette heure. Une moche mèche m’hachait le visage alors que je déglutis péniblement en ravalant la question sui- vante, le prix prohibitif de la bière et de toutes les consom- mations d’ailleurs, l’interdiction de servir de l’alcool après deux heures, tout ça, j’aurais tant aimé savoir ce qu’elle en pensait, mais je lui ai demandé de me faire une coupe bien court partout et surtout autour des oreilles. Elle m’a invité à m’asseoir dans le fauteuil pour le shampoing, la demoiselle. «Asseyez-vous là monsieur, j’arrive, je finis madame et je suis à vous». Je me suis assis. La dame a fini de se consumer sous son cas- que. Et la demoiselle m’a prêté ses jolies petites mains douces de shampouineuse professionnelle --C’est à cause des ces fur- tifs instants de sensualité mousseuse et humide que, doréna- vant, je ne confie plus ma toison crânienne qu’à des femmes.
Sous mon crâne de moins en moins chevelu l’enquêteur, le «bloggeur journaliste» est resté bâillonné (hum, facile, mais pourquoi m’en serais-je abstenu ?). Aucune expression inves- tigatrice n’aura su franchir le mur lamentable de ma sauvage timidité. Quel gâchis ! J’écris de moins en moins et dans cette seule note que je trouve à rédiger en une semaine, plus la moindre information croustillante à offrir aux lecteurs du Plébéien bleu. Que du blabla, des perles en papier ou pire, virtuelles, du vide, juste des mots. Rien. Même pas une seule confirmation de ce qu’il serait si aisé d’inventer ! Juste l’aveu de ces questions qu’il me faudra bien, un jour, me décider à poser. À ma coiffeuse ou à n’importe qui. C’est elle qui m’a appris que Caroline ne travaillait plus là, que comme elle habitait dans les Landes, c’était mieux pour elle maintenant qu’elle coiffait dans un salon à Labenne, je crois. Je ne lui avais rien demandé, à la demoiselle, elle me parlait tout gentiment de tout et de rien, se satisfaisant de mes acquiescements polis, de la pluie et du beau temps, de ma moto, dehors, qui ne craignait rien, je n’avais pas à m’inquiéter car elle jetait régulièrement un œil dessus… Et moi pendant ce temps-là, la boule de plus en plus consciem- ment à zéro, je ressassais mes éternelles questions existen- tielles impossibles à formuler avec la bouche ouverte. Pourquoi ne pouvais-je plus les faire, ces fêtes de Bayonne ? Pourquoi me sentais-je si étranger à ces foules en rouge et blanc ? Pourquoi ces frénétiques libations de destruction massive me terrorisaient à ce point ? Pourquoi la foule me fait-elle peur ? Pourquoi la fête me fait-elle peur ? Pourquoi je n’ose plus demander pourquoi ? Y-a-t-il vraiment eu un mort, ce mercredi des fêtes de Bayonne, dans la rue, là, juste à côté de chez moi ? Est-il possible que quelqu’un invente une histoire pa- reille ? Moi je n’invente plus rien en ce moment et ça me rend un peu triste. Comment aurais-je pu lui parler de ça à la gen- tille demoiselle dont je ne connais même pas le prénom et qui m’a coupé les cheveux bien bien courts, devant-derrière et autour des oreilles ? Je me suis éveillé un instant de ma torpeur agoraphobe pour lui faire remarquer que les ciseaux avec les- quels elle me coupait les cheveux me paraissaient bien petits et elle m’a répondu, toujours souriante, que oui, j’avais probable- ment raison, elle penserait à s’en acheter des mieux, des plus grands et elle s’est tu un instant avant de reprendre le fil de ses commentaires : ça ne doit pas être cool de retrouver sa moto mouillée par la pluie le matin qu’elle a affirmé doctement tandis que mes pensées s’asséchaient de plus en plus dangereuse- ment…
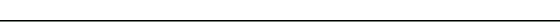
Mes cheveux sont bien courts maintenant, j’en ai pour un bon moment ! Et dire qu’il y a quelques lustres je faisais, comme on dit, tous les jours des fêtes de Bayonne ! J’avais les cheveux bien plus longs, à l’époque.
Le plébéien bleu
22:05 Publié dans digression | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 15 août 2005
À la poursuite des poupées russes
Vacuité toi-même !
Je ne tenais pas particulièrement à le voir. J’étais même un peu étonné que Ramuntxo le programme à l’Atalante. En fait, pour- quoi étais-je étonné ? Vaste question quasi-existentielle pour moi, le cinéphile autoproclamé, pour le cinéma en général, pour les salles art et essais et pour mon ciné préféré en particulier. Cette question --que je n’ose ici formuler clairement-- s’inscrit peut-être dans une interprétation intuitive des propos qu’a tenu ici le programmateur passionné et passionnant sus-nommé... Mais je serais très probablement amené à en reparler, vite, la campagne pour les adhésions et ré-adhésions de l’association gestionnaire, Cinéma et Cultures, commence. Bon, bref, Les poupées russes, le film de Cédric Klapisch, je l’ai vu hier après-midi et j’ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup aimé.
Vala. C’est clair et net, presque concis. J’ai même adoré. Ouais, quasiment tout du long, j’ai pris beaucoup de plaisir. Peut-être, à un moment donné, je ne sais même plus quand exactement, ai-je eu une impression de longueur, furtivement, mais c’est très vite passé (25m x 25m x 250m), impression tout de suite diluée dans un éclat de rire que j’ai eu tant de plaisir à laisser fuser comme pour provoquer en exhibant sans retenue ma joie. Joie de vivre, je veux dire. Oui, la joie de vivre, c’est de ça dont il s’agit dans cette quête permanente de l’amour à l’inté- rieur de l’amour qui cache l’amour en attendant (espérant) le prochain (pourvu que ce ne soit pas le dernier !... et en même temps, pourvu que ce soit LUI, le Vrai, l’Entier, l’Absolu, l’Amour de ma Vie !), l’amour suivant qui n’efface pas le précédent mais qui se trouvait à l’intérieur, le suivant à l’intérieur du précédent comme dans une bien étrange poursuite gigogne. Le Xavier interprété par Romain Duris, je l’ai trouvé tout ce qu’il y a de plus euphorisant avec ses 30 ans qui sont là, juste au bout de cette rue trop droite, trop carrée, trop perpendiculaire, trop symétrique, trop académique, fasciné par la démarche chalou- pée de la plus belle fille du monde. Non, je ne vais pas raconter le film même si j’en meurs d’envie, histoire de retrouver la ba- nane que m’aura offerte Isabelle (interprétée par la géniale Cécile de France) et la dévorer à nouveau par les deux bouts en même temps. à pleine dents comme on mord dans la vie parce qu’un chiffre inscrit à rebours sur une échelle nous fait flipper. C’est immanquable, obli-ga-toire, tout le monde flippe de se voir, de se savoir vieillissant. Et là moi j’ai pris un grand bol de cette vie qui anime les maxillaires, désengorge la glotte et remplit les poumons. Je ne suis vraiment pas du genre à bouder mon plaisir et quand je suis VRAIMENT content… eh bien je pourrais mordre ceux qui veulent gâcher mon plaisir, ma joie. Ouais, je pourrais mordre Jean-Marc Lalanne, critique ci- néma aux Inrockuptibles et Emmanuel Burdeau, son homologue des Cahiers du Cinéma. Bon, OK, c’est un peu facile de vouloir se défouler ainsi mais la facilité n’effraie pas un plébéien bleu et puis ces in-disants culturels mériteraient bien un de ces jours d’être jetés en pâture à une populace déchaînée après la dé- faite de Zinédine Zidane face à Yannick Noah par exemple. C’est juste un exemple, il pourrait bien y avoir un million d’au- tres raisons de condamner les pseudo alibis intellectuels de notre cinéma intelligent à nous qu’on a : leur propre vacuité par exemple… ou leur non-existence tout simplement. Vala. Ça fait du bien à mon ulcère… N’empèche que c’est vachement beau St Pétersbourg !
13:10 Publié dans Cinéma, digression | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 11 août 2005
La string-attitude
Lui fera fermer sa bouche
 Bon, ce n’est vraiment pas mon truc de causer de mode : cet aveu soudain n’étonnera pas grand monde parmi les lecteurs réguliers de ce si joli blog tout bleu… et, tout au contraire, surprendra grande- ment voire subjuguera carré- ment l’ensemble des habitants de mon petit univers si clos d’amitiés sincères. Qu’est-ce qui te prend donc de vouloir ainsi te justifier alors que personne n’a jamais eu l’idée de te brancher sur le sujet de la «fashion victim» ? Hein ! qu’il me dirait Louis*. Mouais, t’es encore démodé, ringard et même pas positif du tout en te figurant être compris par quiconque avec tes jeux de mots à la con ! qu’elle me cracherait poliment au visage, la Sandra** si elle ne se baladait pas présentement en montagne et sous les orages. Bref, je n’ai jamais aimé le string. Ni féminin et encore moins masculin. Je trouve ces bouts de tis- su ou de ficelles parfaitement ridicules. Ridicules et laids. Laids et anti-érotiques. Anti tout court. Anti… mais alors juste un poil trop court, ce poil trop court qui rend l’individu sexué ridicule quand il se veut sexy. Mais, bon, après tout, ce n’est qu’un avis. Le mien. Je n’ai jamais osé faire de réflexions à quiconque con- cernant son string (hum, je sais, il se trouvera forcément quelqu’un pour m’accuser ou me démentir, mais peu importe, là n’est pas le réel objet de cette note). Je ne me le permettrais pas. Non. Sur la plage ou n’importe où ailleurs, très franche- ment, je me vois mal reprocher à mes contemporains de ne pas partager mon sens aigu du ridicule. Ou mes critères du «sexy-attitude», c’est selon, ou vice ou versa. Aucune notion de vertu ou de moralisme ou d’éthique ou de je ne sais quoi à im- poser, ces sentiments me sembleront toujours antinomiques quand je cause de bouts de chiffons ou d’absence de chiffons… Tiens, là je pense en particulier à cette «mode» que je trouve superlativement ridicule et déjà vieille d’au moins un lustre consistant, pour une jeune fille (c’est incommensurablement plus ridicule encore si la jeune fille en question a dépassé l’âge de fréquenter un lycée en tant qu’élève), à exhiber la ficelle ho- rizontale et rectale de son string juste au-dessus de la lisière de son pantalon à taille ultra-basse et jambes éléphantesques. Le top du ridicule étant à mes yeux atteint quand, en sus, la sus-dite demoiselle exhibe dans le même temps et sur ses reins, un large tatouage «tribal». À ce spectacle navrant, je plonge cha- que fois dans le même abîme d’incompréhension, ce même sentiment d’isolement sensoriel extrême m’envahit tout à coup et je me mets à rêver à haute voix de culottes taille basse sous des jean’s moulant, ou mieux encore, sous une jolie et si légère robe à fleurs volant au vent fripon, tout ça, sur le pont, pas de culotte du tout, un oubli, une omission, une coquinerie des plus féminine… mais je m’égare, je me perds, je me damne !... Ça n’existe plus des jeunes filles innocemment aguicheuses, d’ail- leurs, c’est Jean Grenet lui-même qui l’a dit. Les jeunes filles qui choisissent et peaufinent leur vêture moderne du dessus jusqu’au dessous avec le plus parfait ridicule mais aussi parfois animées par la secrète motivation d’aguicher une jeune gente masculine forcément en rut ou tout simplement avinée (à grands coups de «botellons»), ces jeunes filles, disais-je, ou plutôt dit-il, ne peuvent plus être innocentes (a contrario de leurs mères ou grands mères qui dansaient jambes nues et tou- jours innocemment sur les ponts d’Avignon, de Bayonne ou de Pentecôte) et donc, il ne faut pas s’étonner si….
Bon, ce n’est vraiment pas mon truc de causer de mode : cet aveu soudain n’étonnera pas grand monde parmi les lecteurs réguliers de ce si joli blog tout bleu… et, tout au contraire, surprendra grande- ment voire subjuguera carré- ment l’ensemble des habitants de mon petit univers si clos d’amitiés sincères. Qu’est-ce qui te prend donc de vouloir ainsi te justifier alors que personne n’a jamais eu l’idée de te brancher sur le sujet de la «fashion victim» ? Hein ! qu’il me dirait Louis*. Mouais, t’es encore démodé, ringard et même pas positif du tout en te figurant être compris par quiconque avec tes jeux de mots à la con ! qu’elle me cracherait poliment au visage, la Sandra** si elle ne se baladait pas présentement en montagne et sous les orages. Bref, je n’ai jamais aimé le string. Ni féminin et encore moins masculin. Je trouve ces bouts de tis- su ou de ficelles parfaitement ridicules. Ridicules et laids. Laids et anti-érotiques. Anti tout court. Anti… mais alors juste un poil trop court, ce poil trop court qui rend l’individu sexué ridicule quand il se veut sexy. Mais, bon, après tout, ce n’est qu’un avis. Le mien. Je n’ai jamais osé faire de réflexions à quiconque con- cernant son string (hum, je sais, il se trouvera forcément quelqu’un pour m’accuser ou me démentir, mais peu importe, là n’est pas le réel objet de cette note). Je ne me le permettrais pas. Non. Sur la plage ou n’importe où ailleurs, très franche- ment, je me vois mal reprocher à mes contemporains de ne pas partager mon sens aigu du ridicule. Ou mes critères du «sexy-attitude», c’est selon, ou vice ou versa. Aucune notion de vertu ou de moralisme ou d’éthique ou de je ne sais quoi à im- poser, ces sentiments me sembleront toujours antinomiques quand je cause de bouts de chiffons ou d’absence de chiffons… Tiens, là je pense en particulier à cette «mode» que je trouve superlativement ridicule et déjà vieille d’au moins un lustre consistant, pour une jeune fille (c’est incommensurablement plus ridicule encore si la jeune fille en question a dépassé l’âge de fréquenter un lycée en tant qu’élève), à exhiber la ficelle ho- rizontale et rectale de son string juste au-dessus de la lisière de son pantalon à taille ultra-basse et jambes éléphantesques. Le top du ridicule étant à mes yeux atteint quand, en sus, la sus-dite demoiselle exhibe dans le même temps et sur ses reins, un large tatouage «tribal». À ce spectacle navrant, je plonge cha- que fois dans le même abîme d’incompréhension, ce même sentiment d’isolement sensoriel extrême m’envahit tout à coup et je me mets à rêver à haute voix de culottes taille basse sous des jean’s moulant, ou mieux encore, sous une jolie et si légère robe à fleurs volant au vent fripon, tout ça, sur le pont, pas de culotte du tout, un oubli, une omission, une coquinerie des plus féminine… mais je m’égare, je me perds, je me damne !... Ça n’existe plus des jeunes filles innocemment aguicheuses, d’ail- leurs, c’est Jean Grenet lui-même qui l’a dit. Les jeunes filles qui choisissent et peaufinent leur vêture moderne du dessus jusqu’au dessous avec le plus parfait ridicule mais aussi parfois animées par la secrète motivation d’aguicher une jeune gente masculine forcément en rut ou tout simplement avinée (à grands coups de «botellons»), ces jeunes filles, disais-je, ou plutôt dit-il, ne peuvent plus être innocentes (a contrario de leurs mères ou grands mères qui dansaient jambes nues et tou- jours innocemment sur les ponts d’Avignon, de Bayonne ou de Pentecôte) et donc, il ne faut pas s’étonner si….
Ouais, il l’a dit ! Il a osé le dire. J’ai envie de mordre. Il ne l’a pas seulement pensé dans son for intérieur et ravalé sa libido démoniaque du midi de la vie, il l’a dit. J’ai envie de hurler. Et même répété devant des journalistes. J’ai besoin de le hurler par la fenêtre à tout Bayonne. Moi, avec ces histoires de petites culottes, je déconne. Je délire juste, je taquine, je provoque un peu, je tente d’aguicher, quoi ! Un mec censé et respectueux de la féminité au même titre que de sa propre masculinité, un mec comme le plébéien bleu par exemple, eh bien, il a le droit de déconner avec les histoires de petites culottes… mais jamais il n’évoquera le viol comme une «chance». Je le hurle. On n’a pas le droit de dire ou même de penser des trucs pareils. C’est trop grave. C’est un crime, le viol. Hurle. Le criminel n’aura jamais aucune excuse, et la victime aucune part de culpabilité. Une barrière infranchissable les séparera toujours, celle de l’acte, celle du passage à l’acte, celle du crime. Et là, je ne pense pas exagérer si je prétends qu’avec de tels propos tenus en tant que responsable politique élu, Jean Grenet se rend quelque part complice des crimes à venir. Je suis sûr qu’il m’entend là, à l’autre bout de la ville.
Il aura fallu ce grave "dérapage" verbal pour me réveiller quel- que peu de ma léthargie estivale tout autant que post-fêtes de Bayonne que j’ai, disons le, pratiquement boycottées intégrale- ment à titre tout ce qu’il y a de plus personnel et inorganisé. Il aura fallu ce "on a plus de chance de se faire violer" pour me mettre en colère. C’est un pote bloggeur qui m’a refilée l’idée, et si on se débarrassait tous de ces foutus bouts de chiffons qui chatouillent même pas entre les yeux, et si on lui remplissait sa bouche de tous ces strings «appeleurs de crimes» afin de le fai- re taire définitivement devant les micros des journalistes. Oyez- oyez, populace bayonnaise et visiteurs du soir, ayons donc tous pour une fois et spontanément une attitude citoyenne et res- ponsable : la string-attitude !
Ça me fait vraiment drôle de me la jouer comme ça style «ap- pel au peuple» surtout que là, je repense à ces ridicules jeunes filles avec leurs pantalons à la mode d’il y a un lustre et je me dis que, parfois, quand elles se retournent, c’est tout de même bien mimi ce petit bijou dans leur nombril, hum-hum, mais je m’égare encore.
*Louis n’est bien évidemment pas son véritable prénom, pfff.
** Sandra non plus, mais n’empêche que je suis tout de même inquiet à propos des orages en montagne.
23:30 Publié dans digression, politique | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 août 2005
Sous les chemises blanches :
Le ciel est gris, je suis aigri
Le ciel est rose, je suis morose
Trace ta race
Trace !
Détresse...
C’est mercredi dans les rues
Merde-credi !
J’y ai dit
C’est déjà la fête obligatoire
L’ENFIN de l’histoire
C’est déjà la fête finale prise à son début
Au bout de ma rue…
Le boulevard Jean d’Amour fait encore la moue
Au bout de ses guirlandes oubliées
J’ai mis JAMAIS
Écrit en lettres grecques
Écrit au pinceau bleu
Qui décrit si bien les cris des amoureux
Pour faire le break
De mes calendes bayonnaises.
Viens me retrouver Paresse
J’ai pris mes aises
Tristesse.
Trace ta race tristesse !
Sous les chemises blanches
Les gens sont gris
Artifices
Sous les foulards rouges
Plus un cœur ne bouge
Artifesses
Trace ta race
Trace
Artifice-artifesse.
C’est mercredi dans mon lit
Merci Mamour
J’y ai dit
Plus rien n’est pareil avec toi
JAMAIS plus la même histoire
C’est pas banal un bal bacchanales
Dans ton lit
En plein après-midi
Nus sous le drap dans tes bras
Nudité rouge et blanche
Pour faire la fête à tes hanches
La fête initiale de tous les ENFIN
De tous les ENCORE
Tout un mercredi, après-midi
Tout un jour TOUJOURS
Écrit avec mes doigts
Écrit en lettres d’amoureux
Pour t’inventer chaque fois
Un nouveau pont sur l’Adour
Et le franchir avec toi sans nous retourner
Sans plus laisser de trace
Invisibles caresses
Loin des chemises blanches
Trace ta race tristesse !
Et vive l’état de grâce
Loin des foulards rouges !
Mamour, mon Amour
Ma Déesse de Tendresse!
16:35 Publié dans poésie sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)